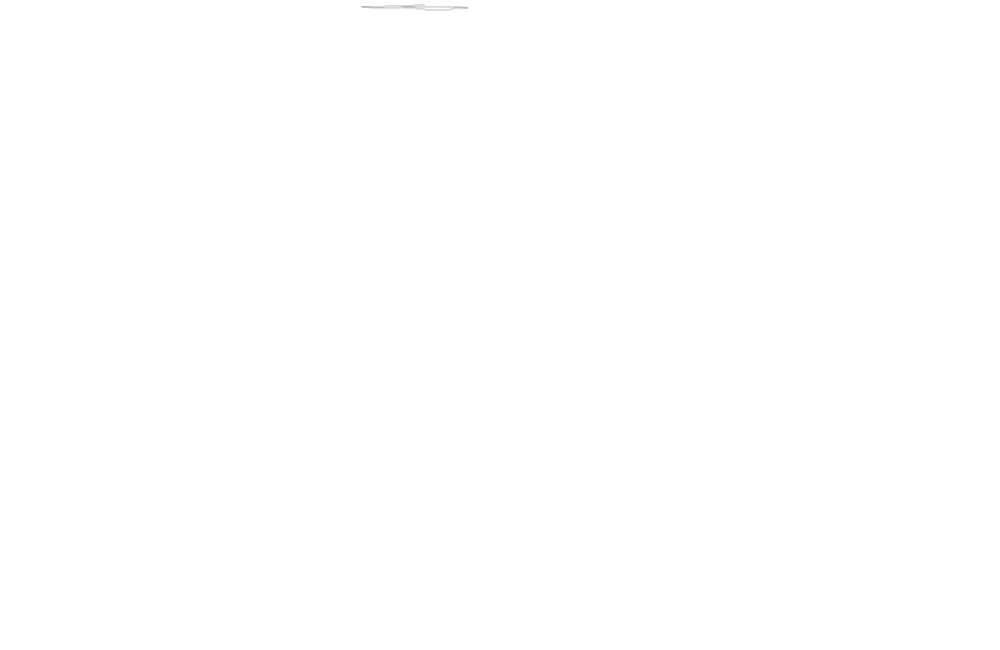Histoire
J’ai vu le jour à Detroit, dans le Michigan, il y a de ça vingt-sept ans maintenant. Naître à Detroit à l’aube d’une énième crise économique… Autant dire que je partais déjà d’un très mauvais pied dans ma vie. Fort heureusement, au-delà des considérations matérielles, je n’ai jamais manqué d’amour de la part de mes parents. J’étais certes une peste avec un sale caractère, mais j’étais surtout fille unique, la petite perle de mes parents qui avaient la fâcheuse tendance de me passer tous mes caprices. Que dire de mon enfance ? Pas grand-chose en réalité… J’étais une gamine turbulente et bavarde à l’école, jamais la dernière dès qu’il s’agissait de faire des conneries ; et encore moins du genre à me laisser faire par les garçons dans la cour de récré. Mais il s’avère que j’étais aussi une fillette brillante, intelligente et rusée. J’assimilais rapidement les connaissances que l’on m’enseignait et avais d’excellents résultats scolaires. J’avais des amis, des camarades de jeu ; une enfance simple et banale en somme.
Le problème à Detroit cependant, c’était le boulot. Parce que l’enfance, c’est bien joli, mais question avenir, c’était quand même pas la panacée. Face à des perspectives plus qu’incertaines à moins de vouloir bosser dans la manufacture et le travail à la chaîne, j’ai rapidement compris qu’un jour, je devrais quitter le nid familial, et même l’État pour me consacrer pleinement à la construction de mon futur. Et mon avenir, je le voyais chaque nuit, quand je levais les yeux vers le ciel. Les étoiles. Si proches, si lointaines… Ce n’était qu’une question de référentiel. J’ai toujours été fascinée par la voûte céleste, son infinie et impénétrable beauté, cette aura chargée de mystères que les hommes et femmes de la NASA et autres agences spatiales à travers le monde tentaient de percer jour après jour, année après année. Dès mes sept ans, je savais que je deviendrais astronaute et qu’un jour, j’aurais la chance d’enfiler une combinaison et monter là-haut, faisant la fierté de mes parents, de mes amis, pourquoi pas de l’humanité tout entière.
Et puis la biologie s’en est mêlée. Ma biologie, mon propre corps me trahissant et détruisant mes rêves de conquête spatiale. À l’âge de douze ans, ma vue commença à décroître, et on me diagnostiqua une myopie. Déjà que j’étais daltonienne, voici que la myopie venait me faucher mes espoirs. Avec une telle tare, je n’avais plus aucune chance d’espérer foutre les pieds dans une navette spatiale, même avec les progrès de la médecine et la possibilité de recourir à la chirurgie ophtalmologique, j’aurais été d’emblée recalée aux examens médicaux. Je n’avais même pas le droit de devenir pilote de ligne à cause d’une vue merdique. Avec une ironie très amère, tous mes rêves de voler un jour s’étaient envolés. Ce que j’ai ressenti en faisant face au fatalisme de la situation ? De la colère, du déni. Non, ce n’était pas possible. Ça ne pouvait pas m’arriver à moi. Pas pour un truc aussi stupide. Et pourtant… J’ai dû surmonter cette épreuve, ce premier obstacle qui se dressait sur mon chemin de vie. Non, je ne serais pas astronaute. Ça m’a pris des mois, juste pour me faire à l’idée ; et presque une année avant de me résoudre à passer à autre chose. On pourrait dire que j’ai connu la dépression à ce moment de ma vie, comme lorsque l’on ressent son premier chagrin d’amour — ce qui viendrait un peu plus tard me concernant — même si avec le recul, je me rendis compte que la dépression, la vraie, était totalement autre chose.
Au fil de mes années lycée, j’ai commencé à me renfermer sur moi-même et à me forger une carapace principalement constituée de supériorité et de dédain. Je réussissais en cours avec une étonnante facilité, suscitant chez mes camarades une certaine jalousie, car j’aurai finalement un avenir plus brillant que le leur, du moins en théorie. J’avais deux-trois véritables amis, sortes de souffre-douleurs officieux du lycée ; nous étions les petits intellos qui rêvaient d’en finir avec le lycée, d’atteindre l’âge adulte et le monde professionnel pour enfin nous révéler à nous-mêmes, aux gens, et prendre notre revanche sur tous ceux qui nous avaient tant fait chier étant plus jeunes. Et en ce qui concernait mon avenir professionnel, j’avais finalement fini par sortir la tête du verre d’eau que j’avais vu trop grand pour me trouver un nouvel idéal à servir et un objectif à atteindre. Puisque je ne pourrais jamais aller dans l’espace, je contribuerais à y envoyer ceux qui le pouvaient. Et quoi de mieux que de vouloir rejoindre la NASA et se lancer dans la recherche aérospatiale, conquérir les étoiles en fabriquant des robots destinés à aller rendre visite à Mars, Vénus, où je ne savais quelle comète au nom impossible à mémoriser… La meilleure université dans le domaine s’avérait être celle d’Austin, au Texas, et il ne fut pas dur de convaincre mes parents de déménager. Mon père mécano et ma mère enseignante n’auraient aucun mal à retrouver du boulot là-bas, plus aisément qu’à Detroit en tout cas, et le climat y était plus clément. En réalité, je me rendais compte que peu de choses nous rattachaient, mes parents et moi, à Detroit. Mes grands-parents paternels vivaient dans le Wisconsin, ceux maternels coulaient une retraite paisible à Miami… Quelques amis que je perdrais de vue quand même en rentrant à l’université. C’était le bon choix et mes parents étaient de toute façon prêts à tout sacrifier pour moi, leur petite chérie adorée.
C’est donc en 25 que j’ai fait mon entrée au sein de l’université du Texas, étudiant avec beaucoup de minutie l’ingénierie mécanique et ses applications dans le domaine de l’aérospatial, avec toutes les contraintes qu’imposait un environnement aussi dur que l’espace. Des théories aux calculs complexes, tout en passant par les progrès presque exponentiels réalisés en ingénierie, informatique et robotique ; à la pratique, tout aussi stricte, au dixième de millimètres près pour assurer la survie de l’équipage que nous finirions un jour par envoyer dans l’espace. Tout se passait excessivement bien. Certes la masse de travail était énorme, les heures passées à plancher sur les cours innombrables, mais quelle satisfaction que de réussir là où beaucoup échouaient, voire abandonnaient purement et simplement. Mon tuteur était relativement fier de moi, mes parents étaient comblés de savoir que leur fille connaîtrait un avenir plus radieux que le leur, même s’ils s’inquiétaient de ne pas me voir m’impliquer un peu plus dans ma vie privée. Il fallait dire que je n’avais pas eu beaucoup de petits copains. Aujourd’hui encore, une seule main me suffit à les compter. Les relations amoureuses n’étaient vraiment pas ma tasse de thé. Déjà, je n’étais pas une fille sexy, je ne faisais rien pour l’être non plus, il fallait bien l’avouer ; mais surtout, j’avais un sale caractère et une fâcheuse tendance à envoyer chier le premier prétendant venu. D’abord mes études, mon utérus attendra.
Malheureusement, comme tout le monde le sait, je n’ai jamais pu finir mon doctorat, cette épidémie de je ne sais quoi de mort-vivant ayant coupé court à mes projets de carrière, de vie, et d’existence. Au début, ce n’était rien d’autre que des faits divers, localisés un petit peu partout à travers le pays, mais qui n’eurent pas un très grand impact sur mon quotidien, hormis celui de distiller lentement une crainte sournoise et une paranoïa que je considérais jusqu’alors comme injustifiées dans les esprits de tous. Pour ma part, optimiste et naïve que j’étais, j’avais confiance dans les progrès de la médecine moderne. J’espérais que le gouvernement et les ONG médicales parviendraient à trouver un remède contre ce nouveau fléau. Nous y étions toujours parvenus, pourquoi serait-ce différent cette fois-ci ? Peut être parce que le gouverneur ne mit guère plus de quelques semaines à placer l’État en quarantaine, à laisser les exilés des autres États trouver mur et portes closes à nos frontières ? Merde ! Étions-nous devenus à ce point paranoïaques et égoïstes ? Non… La réalité fut tout autre et me rattrapa presque malgré moi. Il fallait se rendre à l’évidence, il n’y avait plus de bonnes décisions à prendre. Seulement des décisions pour espérer contenir le fléau ; ou au pire, limiter les dégâts.
Tout le monde ne parlait plus que de ça. De l’épidémie. De la fin du monde. En ce début du mois de mai 2034, plus aucune nouvelle ne nous parvenait du monde extérieur. Nous étions livrés à nous-mêmes, contraints d’attendre la rumeur, affronter nos peurs les plus viscérales, les plus fantasmagoriques. Pour ma part, tout avait cessé. Les cours, l’université, tout cela n’était déjà plus qu’un souvenir abstrait et une incertitude malsaine. Retournerais-je un jour en cours, obtiendrais-je un diplôme ? Que dalle en fait… Les rumeurs se faisaient de plus en plus pressantes. Les forces de l’ordre ne savaient plus où donner de la tête face aux multiples appels et témoignages de la population ; et tandis que la menace se rapprochait insidieusement d’Austin, le chaos frappa la ville bien avant que le premier infecté n’y foute les crocs. Les magasins furent pillés, les rues embouteillées alors que beaucoup voulaient fuir la zone urbaine pour la tranquillité toute relative des campagnes. Certains voulaient partir vers le Mexique, comme si un con de fleuve n’avait jamais empêché un virus de le traverser ; d’autres partir vers le nord. J’ignorais ce qu’étaient devenus tous ces gens. Je l’ignorais et je m’en moquais. Je ne me raccrochais qu’à l’espoir qu’une aide viendrait, que nous n’étions pas la deuxième puissance mondiale pour nous faire trouer la couenne par des rôdeurs. Que nous finirions par vaincre. Je m’aveuglais, c’était tellement plus simple de croire et d’espérer que tout s’arrangerait.
Puis un beau matin, la vague des morts-vivants déferla sur la ville. Tout ce que j’avais pu voir au cinéma comme films d’horreur, en 3D et réalité augmentée, toutes les guerres diverses du globe montrées à la télévision, aux informations ; rien de cela ne pouvait égaler l’horreur, la boucherie qui se déroulait sous nos fenêtres. Mes parents et moi avions suivi les consignes, nous recommandant de nous enfermer chez nous, de nous barricader et de constituer des vivres pour tenir un siège. On avait de quoi tenir un bon mois niveau nourriture, voire un peu plus en nous rationnant, mais la question n’était pas de savoir combien de temps nos vivres tiendraient ; mais juste combien de temps notre porte résisterait aux assauts des infectés. Les râles dans le couloir, les hurlements de ceux qui tombaient sous les chicots des goules insatiables en se faisant arracher les tripes, les sirènes d’alarme des voitures bousculées, renversées, enflammées… J’avais beau être capable de donner une définition du chaos, je me révélais cependant incapable d’en donner une description avec des mots. Ce que je ressentais, ce que je pensais, ce que je vivais à ce moment-là. Ce n’était pas de la peur, de la terreur, de l’incompréhension ou du déni. C’était un mélange de tout ça, un plasma d’émotions toutes plus contradictoires et violentes les unes que les autres.
Les infectés s’acharnaient sans relâche contre le battant de notre porte ; et toute blindée était-elle, elle finirait par lâcher. Tout ne se résumait qu’au seul facteur temps. C’était la seule variable qui faisait encore la différence entre sécurité et danger, entre contrôle ridiculement maigre et chaos le plus total, entre la vie et la mort. Mon père avait sorti son Colt et les dix-huit cartouches qui le nourrissaient, pour nous protéger quand le moment viendrait. Mais en réalité, ce flingue ne nous protégerait pas, jamais. Il ne ferait que retarder une échéance que je voyais déjà fatalement arriver. Il la retarderait de dix-huit détonations, peut-être moins, dix-huit coups de semonce qui sonneraient le glas de notre existence. Mais notre porte tint le choc, renforcée par la bibliothèque, une armoire et le canapé, elle absorba les chocs sourds et intarissables des infectés se pressant contre elle, mugissant leur férocité inhumaine, leur voracité insatiable durant des heures et des heures. Quarante-trois exactement. Quarante-trois heures que nous avions passées blottis les uns contre les autres, sans que la pression ne se relâche jamais, ma mère et moi derrière mon père, à gémir tout notre désarroi, à pleurer notre impuissance et à attendre notre fin proche. Et si notre porte n’a finalement jamais lâché, c’est bel et bien celle de l’appartement d’en dessous qui le fit, et notre voisin, dans sa grande intelligence, n’a rien trouvé de plus malin à faire que de fuir par l’escalier de secours de notre immeuble, ouvrant par la même la voie aux infectés qui arpentaient les couloirs et cage d’escalier de notre bâtiment. C’est donc par la fenêtre de ma chambre que la première de ces saloperies est entrée chez nous avant de se ruer dans l’appartement.
Mon père tira à trois reprises dans le cadavre ambulant avant que celui-ci ne s’effondre, inerte pour toujours, en répandant sa cervelle sur notre plancher. Mais d’autres arrivèrent à sa suite, et nous n’avions plus d’autres choix que de fuir, de tout laisser derrière nous pour espérer avoir encore un avenir devant nous. Nous nous engageâmes sur les escaliers de secours, luttant contre les infectés qui montaient vers nous, mon père tirant quelques ogives dans l’espoir de se frayer un chemin, renforçant sa progression de quelques coups de semelles depuis sa position dominante et envoyant valser quelques rôdeurs dans le vide par-dessus le garde-fou. Et plus nous descendions vers le plancher des vaches, plus je voyais l’inévitable se rapprocher de nous. Nous allions nous faire bouffer. Des centaines de ces saloperies inondaient les rues, coinçaient les vivants pour les dévorer sans état d’âme, et sans jamais être rassasiées à ce qu’il me semblait. Mon père nous tirait vers l’avant, vers le sol, et ma mère me poussait au cul pour que j’avance le plus vite possible. Puis un des rôdeurs lui agrippa les cheveux par une fenêtre. Elle hurla. Jamais je ne pourrais oublier son hurlement strident. Des dizaines de décibels de pure terreur. Mon père tenta bien de l’aider, mais la situation était bien trop chaotique, les monstres bien trop nombreux. Je lui pris la main, l’appelai de toutes mes cordes vocales, les yeux embués de larmes et mon esprit ne sachant que faire. Je n’avais rien, je n’étais rien. Plus de logique, plus de raison, même pas la moindre idée de ce que je pouvais faire. Je ne pouvais rien faire d’autre que contempler mon inutilité, la futilité de ma tentative. Je hurlai
"maman" à m’en faire péter les cordes vocales, mais finalement, je ne pouvais que subir, encaisser le choc et avancer malgré moi. Sans volonté autre que d’essayer de sortir de ce merdier. Alors mon père m’a pris par le bras et m’a tiré vers lui, m’obligeant à lâcher la main de ma mère, à l’abandonner là, condamnée à son sort quand j’étais condamnée à ne rien pouvoir changer à cela. Je me débattis, mais mon père avait de la poigne et agissait seulement par une rage de vivre que je ne lui connaissais pas. Il était effrayant, méconnaissable. Je pouvais dire qu’il m’avait littéralement sauvé la vie ce jour-là, m’arrachant à ma stupeur et mon effroi pour me forcer à avancer de quelques coups de pied au cul métaphoriques.
Lorsque nous atteignîmes enfin le sol, la situation ne s’arrangea pas. Les infectés se ruèrent sur nous, à notre poursuite. Devant, derrière, de tous les putains de côtés. C’était à se demander s’il n’allait pas aussi en jaillir du sol et des cieux pour mieux nous écraser sous leur nombre incommensurable. Nous avons couru, droit devant, vers le moindre espace qui n’offrait pas à notre vue de chair putréfiée et sanguinolente. On a foncé dans le tas, mon père dressant sa musculature relativement colossale devant moi pour nous frayer un chemin entre les avant-bras décharnés qui jaillissaient devant nous pour nous agripper, nous happer vers des bouches voraces. Nous avons trouvé une bagnole, moteur allumé et portières ouvertes, dont les occupants avaient fui ou s’étaient fait emporter par la foule de monstruosités. Je n’en savais rien et m’en cognais éperdument. Nous avons foncé, droit devant, renversant les corps en décomposition comme de vulgaires quilles aux aspects de pantins désarticulés. Jamais je n’avais vu mon père dans un tel état de rage, animé d’une telle volonté de survivre, de me protéger. Si j’apprenais plus tard que cette apocalypse pouvait faire ressortir le pire côté des gens, j’avais aussi eu la preuve qu’elle pouvait en extraire le meilleur. L’homme était et resterait plein de ressources insoupçonnées. Prostrée sur le siège passager, je restais muette, terrorisée, mon corps tremblait si violemment que j’en attrapais des nausées, je m’inventais des douleurs.
"On doit retourner chercher maman !" hurlai-je, paniquée, déboussolée, à mon père, sans saisir toute la stupidité de mes propos. J’étais en état de choc, complètement délirante. Puis je m’étais effondrée, pleurant, hurlant, prenant ma tignasse entre mes mains ou frappant du poing contre le tableau de bord.
Finalement, nous avons fini par atteindre la sortie de la ville, laissant derrière nous cette silhouette urbaine d’où s’élevaient de longues colonnes de fumée noire répandant une odeur âcre dans l’atmosphère, se mêlant à l’odeur pestilentielle des cadavres en décomposition et celle plus cuivrée du sang frais. Mon père roulait droit vers nulle part. Nous ne savions pas quoi faire, ni même où aller ; et après deux heures à arpenter des routes de campagne, nous tombâmes en panne sèche, au milieu de nulle part. Destination atteinte en quelque sorte. Des champs à perte de vue, avec quelques corps de ferme qui semblaient avoir été épargnés, pour l’instant. Nous marchâmes en direction du plus proche d’entre eux, mais mon père ne fit même pas cent mètres à travers qu’il s’écroula dans les herbes hautes, la respiration haletante. Inquiète, toujours aussi paniquée, je m’agenouillai à ses côtés, le secouant en lui demandant ce qui n’allait pas ; puis remarquai les nombreuses griffures qui parcouraient ses bras, ses mollets. Il délirait par intermittence, en proie à d’atroces douleurs musculaires et des spasmes incontrôlés. Je posai ma main sur son front et constatai qu’il était brûlant de fièvre. Le souffle semblait lui manquer, comme s’il se noyait dans l’air même. Ses lèvres se cyanosaient à vue d’œil et je le vis tendre une main tremblante et suppliante dans ma direction, plus qu’une main… Une arme, son arme. Je ne pouvais détacher mes noisettes de son regard m’appelant d’une seule supplique, m’ordonnant d’accomplir une chose que j’étais incapable de faire, que je répugnais. Le tuer. Lui. Non.
"NON !" Je secouai la tête, me relevai en titubant de quelques pas en arrière, lâchant sa main, oubliant son arme et l’abandonnant à sa maladie sans pouvoir détacher mon regard du sien. Je rejetai cette idée, la niai d’un seul bloc. Il était hors de question que j’abatte mon père, mon sauveur et mon héros. J’avais déjà abandonné ma mère quelques heures plus tôt… Je ne pouvais pas tuer le seul être cher qui me restait à cet instant, le seul point d’ancrage que je gardais dans ma vie et qui agonisait sous mes yeux.
"Princesse… Pitié…" articula-t-il d’une voix étouffée, déformée par la douleur et les sanglots. La voix tremblante, je secouai à nouveau la tête, plaquant mes mains sur ma bouche avant de chasser mes larmes, puis lâchai un faible
"j’peux pas…" avant de détourner le regard, puis les talons et m’enfuir à travers champ, vers le corps de ferme, en gémissant, la vue brouillée de larmes. Je chutais à trois reprises durant ma course folle, m’écorchant les genoux, les coudes. Après plusieurs minutes à courir comme une dératée, je franchissais la clôture en bois de la ferme et fonçais droit vers le ranch, m’écrasant de tout mon poids contre la porte d’entrée pour me jeter à l’intérieur, arrachant un sursaut de surprise à toute la famille de fermiers installés à table. Je les dévisageais tous un à un, tout aussi surprise qu’ils l’étaient, la respiration haletante, mes cheveux poisseux de sueur collés à mon visage. Les yeux écarquillés, je ne parvins à n’articuler rien d’autre qu’un malheureux
"Aidez-moi…" secoué de sanglots suppliants avant de m’effondrer, inconsciente et en état de choc.
Lorsque je me réveillais enfin, c’était dans un hurlement provoqué par un cauchemar, ou un souvenir, probablement un mélange des deux, me redressant dans un lit sans savoir où j’étais ni combien de temps j’avais dormi. Un type était assis non loin de moi, se redressant d’un seul coup pour venir me calmer, me prenant la main et me parlant avec des mots doux, une voix posée, mais autoritaire. Il m’expliqua rapidement qu’il était le propriétaire du ranch où j’avais atterri et que j’étais en sécurité. Rapidement, j’essayais de retrouver un semblant de calme, mais mon esprit, mes idées étaient confus. Lentement, avec hésitation et dans un récit complètement anachronique, je parvenais enfin à lui raconter mon histoire, ce que nous avions vécu à Austin, ce qui s’était passé et qu’elle était la menace qui planait sur son ranch, sur nos épaules, sur l’humanité tout entière. Il tâcha de me rassurer comme il le put, m’informant qu’ils étaient au courant, qu’ils avaient de quoi se défendre et qu’ils étaient plutôt isolés dans la campagne, mais à nouveau je m’effondrais en sanglots et me renfermais sur moi-même, refusant tout contact, toute parole ; alors que les atroces souvenirs d’Austin affluaient à mon esprit et m’arrachaient à cette réalité pour me replonger dans les limbes les plus obscurs de ma terreur.
Et le temps passa ainsi, s’écoula lentement dans une relative tranquillité au sein de ce ranch, les jours se muant en semaines bien avant qu’une horde conséquente de rôdeurs ne débarque. Pour ma part, j’avais retrouvé un semblant de contenance lorsque j’étais réveillée, aidant la famille aux travaux de la ferme et à monter des barricades, m’occupant notamment de réparer un vieux tracteur essoufflé et usé par les années de labeur agricole. Depuis mon arrivée, les fermiers n’avaient vu débarquer aucun autre survivant ni même croisé la moindre âme qui vive, à l’exception de quelques zombies isolés qu’un coup de douze avait renvoyés ad patres. Mes nuits n’étaient qu’une succession de cauchemars horribles, où je revivais inlassablement ma lâcheté face à la mort de mes parents, surtout le sort auquel j’avais abandonné mon père. La culpabilité me rongeait dès que je me laissais gagner par un instant d’oisiveté, alors je travaillais, je m’occupais l’esprit pour ne pas y penser, je m’épuisais même aux tâches agricoles de ce début d’été dans le seul but d’abrutir ma conscience et diluer ma peine et mes tourments. Là encore, seul le temps finirait par me libérer. C’est au mois de juillet que la première horde d’envergures fit son apparition à l’horizon, une légère brise chaude trahissant sa présence en portant jusqu’au ranch l’odeur pestilentielle des morts en approche. Toute la famille s’équipa d’armes à feu, le père et ses deux fils montant dans le pick-up familial pour aller arroser d’une première salve de plomb les zombies en approche. Mais d’expérience, je savais que ce serait bien insuffisant pour les arrêter. Rien ne les arrêtait, jamais. Le désespoir m’avait consumé. Je n’avais même plus eu le goût de me préparer à défendre ma vie, seulement à savourer le peu de temps qu’il me restait à attendre auprès de ces braves gens, et que la mort vienne enfin me cueillir, ne vienne m’emporter auprès de mes parents. Et la horde déferla sur le ranch, détruisant les barricades de pieux et de barbelés, ignorant les balles, les coups de pelles et de pioches ou encore la calandre avant du tracteur et ses socs de charrue que je conduisais à travers la masse grouillante. Rien n’arrêtait la progression de la horde. Face à l’inévitable, ces fermiers, mes sauveurs auraient pu choisir de fuir, sauver leur vie… mais ce ranch était leur vie, et il était devenu la mienne par procuration, pour quelques semaines de plus sur Terre. Ou en enfer plus exactement, alors tous l’ont défendu chèrement et ont fini par en payer le prix. Pour ma part, je refusais la fuite. Pas cette fois. Au milieu des cris, des hurlements de rage et de désespoir, au milieu des coups de feu, l’un d’eux a fini par m’avoir sur le siège du tracteur, plantant ses chicots dégueulasses dans mon mollet gauche et arrachant un morceau de chair encore palpitante à ma jambe. Je hurlais de douleur, puis repoussais le monstre d’un coup de semelle, lui explosant le nez en un craquement sinistre, avant d’enfoncer encore plus la pédale d’accélérateur, faisant le vœu d’en écraser le plus possible avant de les rejoindre.
Je sentais mon sang ruisseler le long de ma cheville, inonder et détremper ma chaussette puis ma godasse alors que la douleur se diffusait atrocement le long de la plaie. Une dizaine de minutes plus tard, je sentais ma jambe partir dans des spasmes que je ne parvenais pas à contrôler, faisant faire des soubresauts au vieil engin. À mon regard s’offrait la grange, droit devant moi, où s’accumulait une population encore plus importante de rôdeurs qui grognaient et glapissaient vers moi, et ce tracteur. Au fil des minutes, alors qu’une fièvre abominable me gagnait, je sentais monter en moi cette rage indicible, cette colère sourde et bouillante qui appelait la vengeance. Vengeance pour ma mère, mon père. Vengeance pour ma carrière, mes amis. Vengeance pour ma vie et le bonheur que je ne connaîtrai jamais. J’enfonçais mon pied sur l’accélérateur autant que je le pouvais au milieu des spasmes de plus en plus violents et fréquents qui me secouaient, puis fonçais finalement dans le mur de planches en bois avec l’engin, provoquant l’effondrement de celui-ci dans un fracas assourdissant qui eut tôt fait de m’enterrer dans la cabine du tracteur, brisant les dernières vitres que les infectés n’avaient pas encore mises à mal. L’engin cala, au milieu des débris amoncelés, de la poussière de paille et de l’odeur fétide du mort-vivant en chasse. Ainsi ce tracteur serait ma tombe. Ce n’était pas un endroit pire qu’un autre pour mourir. Quelle importance de toute façon ? Je sentais mes forces m’abandonner, mes poumons s’enflammer au rythme de ma respiration saccadée, et ma lente agonie qui ne faisait que s’étirer dans le temps. Toujours le temps, ce putain de temps… Vautrée dans le siège du tracteur, j’appelais la mort de toute ma volonté, mon regard se troublant et s’irisant quand la fièvre m’arrachait un rire d’abandon délirant. Puis vint une pression dans ma poitrine, une pointe acérée me transperçant le cœur de part en part, arrachant à mes lèvres étirées d’un mince sourire soulagé, mon dernier soupir tant espéré.